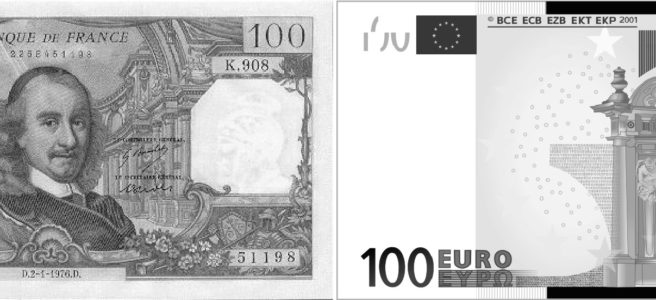Ce dont les chercheurs ont besoin, c’est de soutien de base pour les laboratoires…
Le financement sur projet, c’est mal…
librement inspiré de messages sur les réseaux sociaux
Le financement de la recherche publique française a beaucoup changé au cours des trois ou quatre dernières décennies. Beaucoup y voient d’abord la conséquence de décisions politiques successives de changer le système, avec un transfert d’un modèle de financement récurrent vers un financement sur projet.
C’est vrai.
Mais je pense que ce n’est pas la seule cause. Nous aussi nous avons changé. La manière opérationnelle dont se fait la science dans les labos a considérablement évolué et a induit des modifications qui ont aussi transformé les besoins de financement des chercheurs (en biologie, au moins…). Ceci a renforcé le changement de modèle et notre dépendance au financement sur projet.
Du financement récurrent au financement sur projet
Dans le présent climat pré-LPPR électrique, certains prônent le retour au « tout financement récurrent ». Je pense que ce n’est pas possible. Parce que le système a changé, on ne pourra pas faire rentrer le dentifrice dans le tube maintenant qu’il en est sorti. Ce billet a pour objet de vous présenter une analyse de ce point de vue personnel.
Pour autant, comme pratiquement toute notre communauté, je suis très attaché à préserver une recherche fondamentale libre, créative, ouverte, poussée par la curiosité. Une véritable blue sky research, comme disent nos collègues anglo-saxons. Trouver comment concilier financement sur projet et liberté de recherche est donc un enjeu essentiel.
J’essaierai de proposer des éléments de réponse dans un prochain billet, mais pour l’instant, je vous livre mon analyse de comment et pourquoi nous aussi nous avons changé et favorisé l’installation du financement sur projet dans le paysage, au moins dans le domaine de certaines sciences expérimentales comme la biologie.
A long time ago, in a far, far away galaxy…
De mémoire, au tout début de mon activité de recherche , le laboratoire dans lequel j’ai fait ma thèse fonctionnait pratiquement sur les seuls soutiens de base annuels de ses deux tutelles CNRS et université. Pas besoin de contrats de recherche.
Je sais, ça fait ancien combattant… et c’est dur à imaginer pour les plus jeunes générations nourries à l’ANR et autres guichets de financement compétitifs. Bon, j’idéalise probablement un peu les choses avec le recul, et comme doctorant je n’avais pas de vision très précise de qui payait quoi dans le labo. Et puis ça couvrait juste le fonctionnement de base, pas l’achat de nouveaux équipements pour lesquels il fallait faire des demandes spécifiques.
C’était de la science de qualité pour l’époque, mais artisanale et pas chère. Et tout à changé.
Aujourd’hui, si vous interrogez un directeur d’UMR dans ma discipline en lui demandant quelle part représente le financement récurrent de ses tutelles dans son budget de fonctionnement (CNRS, INSERM, université…), il vous répondra probablement quelque chose comme environ 20%, pas plus. Les 80% restant sont des contrats.
Si la part des contrats est si importante aujourd’hui et qu’on n’est plus dans la situation « idyllique » que je décrivais plus haut en évoquant mon début de carrière, ce n’est pas parce que le financement récurrent s’est effondré au profit du financement sur projet. C’est surtout parce que la recherche dans ma discipline, et probablement dans d’autres, coute plus cher, beaucoup plus cher qu’auparavant.
De la science de garage…
La science expérimentale que nous faisions il y a une trentaine d’années n’avait pas besoin de beaucoup de choses. Pour caricaturer un peu, quelques pipettes, des boites de Petri, des tubes (beaucoup en verre, pas jetables, donc réutilisables, moins cher à l’usage…) et le tour était joué.
Peu de gros équipements sophistiqués. Ça n’existait pas vraiment et nous n’en avions pas besoin. Avec mes collègues chimistes du département voisin, nous distillions et redistillions nous-mêmes nos solvants (eau, éthanol, éther, phénol…), ce qui était très économique. Ils avaient construits eux-mêmes en partie un de leur spectromètres avec l’atelier d’électronique du site, en assemblant des éléments de base (pompes, amplis…). Et leur verrerie de laboratoire était fabriquée et réparée par le souffleur de verre installé à coté.
Depuis, le souffleur de verre n’a pas été remplacé quand il est parti à la retraite et les chimistes ont acheté un spectro dernier cri off-the-shelf chez un constructeur. Leur vieil instrument maison prend la poussière à la cave… Et on ne redistille plus les solvants, on les achète prêts à l’emploi. Ce n’est pas pour des raisons d’économie, c’est parce que les besoins et les contraintes ont changé.
…à la science high-tech
En 30 ans, la science expérimentale s’est accélérée, technicisée et parfois industrialisée (par exemple dans les programmes -omiques en biologie : génomique…). Les instruments sont devenus plus performants, plus sensibles, plus automatisés, plus informatisés, plus nombreux. Ce sont des bijoux associant des technologies multiples, si complexes qu’un laboratoire de recherche académique standard n’est plus en capacité de le construire ou de l’assembler lui-même. C’est cher, ça évolue vite et il faut les renouveler fréquemment si on veut continuer à être compétitif.
La biologie a aussi vu la multiplication des « kits », des ensembles de réactifs et de consommables prêts à l’emploi pour effectuer une tâche précise : extraire l’ADN d’une cellule, faire un test de détection par un anticorps… Là où il y a 20 ans, le chercheur préparait avec grand soin ses réactifs et ses solutions (ses « sauces« , dans notre jargon), aujourd’hui il achète une boite où tout est prêt, ce qui lui fait gagner un temps fou. C’est un peu comme la différence entre un plat tout préparé qu’on réchauffe au micro-ondes et la daube préparée amoureusement à l’ancienne par grand-mère pendant des heures. Les kits, c’est rapide, c’est simple d’usage, c’est fiable, mais c’est aussi beaucoup plus cher. Et c’est devenu presque incontournable si on veut être efficace.
La science expérimentale s’est aussi considérablement réglementée, au bénéfice de la sécurité des personnels de la recherche ou du bien-être des animaux de laboratoire. On ne peut plus manipuler des produits dangereux sans installations super-sécurisées, les contraintes de ventilation et de confinement des animaleries sont devenues draconiennes et les normes sur les sorbonnes des chimistes se sont renforcées, pour ne citer que ce que je connais. Il faut aussi financer des contrats de maintenance, de certification, de sécurité sur tous ces équipements. On doit s’en réjouir, mais tout ça coute aussi beaucoup plus cher en coûts de fonctionnement.
Changement de paradigme
Alors bien sûr, tout ce que je vous raconte est très lié à ma discipline. Probablement mes collègues juristes, sociologues ou mathématiciens n’ont pas vécu une transition aussi marquée. Parce que les coûts de fonctionnement de leurs spécialités ne sont pas du même ordre. Mais j’ai la faiblesse de croire que c’est une tendance de fond qui a un impact global sur l’équilibre du système, en raison du poids des disciplines expérimentales dans le coût de fonctionnement global de la recherche.
Dans l’ancien modèle d’il y a 30 ans, beaucoup des coûts étaient quasiment fixes, limités et donc globalement finançables sur le soutien de base. Aujourd’hui, ils sont plus importants et beaucoup plus liés à l’intensité des projets de recherche menés dans le labo (l’utilisation de cages dans des animaleries aux normes, des kits de réactifs, des consommables « captifs » et onéreux pour des appareils high-tech…).
Ce sont les financements sur projet qui ont permis de payer ça. Ça a indiscutablement donné un coup d’accélérateur spectaculaire à la recherche. On s’y est rapidement habitué et ça a modifié nos modes de fonctionnement, de construction de projets, et même d’organisation des labos. Ça a aussi été renforcé chez les biologistes par une spécificité supplémentaire. Dans notre discipline, il y a beaucoup de guichets de financements de projets, notamment les grands acteurs caritatifs : Fondation pour la recherche médicale, ARC, Ligue contre le cancer, AFM-Téléthon, Vaincre la mucoviscidose, Sidaction… Collectivement, leur contribution doit aujourd’hui dépasser celle de l’ANR en biologie-santé.
Revenir en arrière de manière majeure sur les financements sur projet ne me paraît pas réaliste, parce qu’une partie substantielle des besoins est désormais structurellement très liée aux programmes de recherche, à leur contenu, à leur volumétrie et qu’il est difficile de programmer ça en majorité sur des moyens récurrents augmentés : comment seraient-ils répartis par les tutelles ? avec quelles procédures ? qui arbitre ? sur quels critères ?
Liste au Père Noël
Ce dont les chercheurs ont besoin, à mon sens, c’est de trois choses :
- Un taux raisonnable de succès aux appels à projets, pour permettre de financer la recherche et éviter l’épuisement et le découragement des équipes et des chercheurs. Raisonnable, c’est beaucoup plus qu’aujourd’hui (un prochain billet abordera la question).
- Le maintien d’une fraction majoritaire de projets blancs, ouverts. Pour garantir de la liberté indispensable à une recherche créative.
- Des moyens complémentaires pour mener des recherches exploratoires, de préférence mobilisables de manière réactive, avec un minimum de procédures.